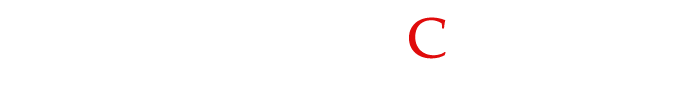La maladie du sentiment « anti-japonais »
« Le mal de l’anti-japonaise » – Le point de vue d’un ancien journaliste du Yomiuri Shimbun
9 août 2018
Ce qui suit est un chapitre que j’ai initialement publié le 27 juin 2018. Il mérite d’être relu, tant au Japon qu’à l’étranger.
Toutes les mises en évidence dans le texte ci-dessous sont de moi.
Le mal de l’anti-japonaise
J’ai travaillé comme journaliste pour le Yomiuri Shimbun pendant plus de 20 ans, et tout au long de cette période, j’ai toujours nourri de sérieux doutes quant à la position journalistique de l’Asahi Shimbun, en particulier sa tendance à privilégier l’idéologie au détriment des faits.
Lorsque j’ai découvert qu’un de leurs articles concernant l’article 9 de la Constitution avait été fabriqué de toutes pièces, j’ai été submergé par une émotion proche de la rage. Il s’agissait ni plus ni moins d’un sacrilège envers le journalisme.
En même temps, je me suis demandé s’il n’y avait pas une sorte de maladie psychologique à l’origine du fait qu’un journal puisse systématiquement fabriquer des informations.
Pourquoi fabriquent-ils ? Ou plus précisément, comment est-ce possible ?
En réfléchissant à cela, je me suis souvenu d’une remarque faite un jour par un historien allemand sur « l’étude de l’histoire à travers la psychologie ». Cela m’a amené à me demander si l’Asahi Shimbun et d’autres intellectuels progressistes de la gauche japonaise pouvaient être analysés à travers le prisme de la psychanalyse.
Cette réflexion a été le catalyseur de mon livre : La maladie de l’« anti-Japon » – Défaire le lavage de cerveau du peuple japonais par le GHQ et les médias (éditions Gentosha).
Les conservateurs japonais critiquent souvent l’Asahi Shimbun en le qualifiant de « masochiste ».
En effet, il est compréhensible que beaucoup perçoivent ainsi un média japonais qui se livre constamment à des reportages nuisibles aux intérêts nationaux du pays.
Cependant, paradoxalement, j’en suis arrivé à la conclusion que l’Asahi Shimbun pourrait en fait être l’organisation la plus narcissique qui soit.
En d’autres termes, le journal est animé par une image de soi en tant que « bon Japonais », par opposition aux « mauvais Japonais » qui ne parviennent pas à expier le passé guerrier du Japon. Cet instinct d’autoprotection et cette vision moraliste du monde sont, selon moi, ce qui pousse l’Asahi Shimbun à fabriquer des histoires.
Lorsque j’ai lu cette hypothèse, j’ai immédiatement pensé à quelque chose, à savoir qu’elle expliquait la psychologie de Tsujimoto Kiyomi, que la NHK insiste pour faire passer à l’antenne malgré le fait qu’elle ait été initialement arrêtée pour des activités criminelles. Tout cela semblait parfaitement logique.
Lorsque j’ai consulté un psychiatre à propos de cette hypothèse, il m’a répondu : « Oui, l’Asahi Shimbun présente de nombreux traits caractéristiques du trouble de la personnalité narcissique. »
Ce trouble pourrait en effet être rebaptisé « maladie anti-Japon ».
Bien sûr, tout le monde possède un certain degré de narcissisme. Mais lorsque ce narcissisme devient excessif, il crée inévitablement des frictions avec les autres.
Dans le cas de l’Asahi Shimbun, son amour-propre excessif a provoqué des conflits avec la société japonaise et le peuple japonais.
Le pire exemple en est sa couverture de la question des femmes de réconfort.
Au lieu de baser ses articles sur des faits issus d’un travail d’investigation approfondi, l’Asahi Shimbun a continué pendant des années à publier des articles fondés sur les mensonges de Seiji Yoshida.
Comme le fondement était faux dès le départ, tout ce qui a suivi n’était que pure fiction.
Ses reportages sur le massacre de Nankin et les questions relatives aux manuels scolaires sont probablement également le fruit de ce narcissisme démesuré, mais quelle que soit l’intention, il est indéniable que les reportages de l’Asahi Shimbun ont tendu les relations avec les pays voisins et gravement nui à la réputation internationale du Japon.