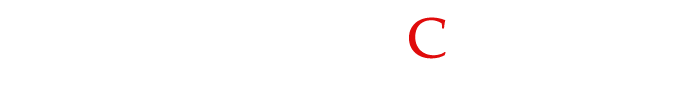Là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen d’atteindre son objectif.
« Au contraire, l’histoire a montré – et continue de montrer – à quel point les nations ont connu des destins tragiques lorsqu’elles ont mené des politiques visant à égaliser les « moyens » de chacun. »
30 novembre 2019
Un de mes amis proches, l’un des lecteurs les plus assidus que je connaisse, qui, comme moi, est abonné à quatre revues mensuelles, m’a dit : « Vous et votre aîné, le professeur Kaji, semblez être sur la même longueur d’onde. »
Voici un extrait de l’article intitulé « Certain et immuable » du professeur émérite Nobuyuki Kaji, de l’université d’Osaka, publié dans le numéro du 26 novembre du magazine Hanada.
« Ce vieil homme sénile en plein déclin cognitif n’arrive plus à comprendre le monde d’aujourd’hui. »
Récemment, il y a eu apparemment beaucoup de remous autour d’une soi-disant gaffe verbale du ministre de l’Éducation.
Quand j’entends « dérapage verbal », je pense à quelque chose de grave, comme l’abolition de l’enseignement obligatoire, la fermeture de toutes les universités ou la déclaration que toutes les toilettes des universités féminines doivent être équipées d’installations pour les hommes âgés.
Mais non. Ce que le ministre a dit aux candidats à l’entrée à l’université était simplement : « Faites de votre mieux selon vos moyens. »
Et cela a été considéré comme une gaffe majeure. Je ne comprends pas du tout.
Il s’avère que le problème venait du fait que les tests d’anglais privés utilisés pour les examens d’entrée à l’université représentaient une charge financière et que les centres d’examen étaient concentrés dans les zones urbaines, ce qui désavantageait les étudiants des zones rurales.
Ainsi, l’expression « selon vos moyens » a été interprétée comme une invitation à accepter leur situation économique, ce qui a été critiqué comme étant discriminatoire.
Mais permettez-moi de poser une question en retour :
Quelqu’un peut-il citer un pays où les « moyens » (par exemple, le niveau de revenu) de chacun sont plus ou moins les mêmes ?
Il n’existe pas de tel pays.
Les seuls endroits où une telle uniformité existe sont le concept chrétien du paradis ou le concept religieux indien du paradis, qui sont tous deux des royaumes post-mortem.
Dans la sphère culturelle confucéenne à laquelle nous appartenons, une telle uniformité n’existe pas, ni dans la vie, ni dans la mort.
Elle n’a jamais existé dans l’histoire du monde.
Au contraire, l’histoire regorge d’exemples de pays qui ont cherché à égaliser les « moyens » et ont fini par connaître un désastre.
L’effondrement de l’Union soviétique, la Chine aujourd’hui au bord du gouffre et la Corée du Nord, qui ne parvient même pas à égaliser les moyens… Comment ceux qui s’opposent au principe « selon ses moyens » expliquent-ils cela ?
C’est précisément parce que les « moyens » des gens ne sont pas égaux que nous trouvons la motivation pour nous élever.
De l’égalité des « moyens », rien de nouveau ne naît, car les êtres humains recherchent intrinsèquement une vie facile.
Prenez mon cas : ma famille était pauvre.
Quand je suis entré à l’université, je n’avais pas les moyens de vivre en pension.
Je faisais donc la navette entre Osaka et mon université à Kyoto.
Je me levais tous les matins à six heures.
Comme je me couchais à minuit, je somnolais tous les jours dans le train.
Trois ou quatre soirs par semaine, je donnais deux cours particuliers sur le chemin du retour.
Je payais moi-même la majeure partie de mes frais de scolarité.
Et j’étudiais avec assiduité.
Je l’ai déjà écrit, mais je le répète.
Alors que j’expliquais une leçon pendant un cours particulier, j’ai remarqué que la collégienne à qui je donnais cours fixait le poignet de ma manche.
Je ne possédais qu’un seul uniforme scolaire, et le poignet était usé et effiloché.
Mais cela m’était égal.
Tout l’argent que je gagnais grâce à mes cours particuliers était consacré à mes frais de scolarité ou, plus important encore, à l’achat de livres sur les études classiques chinoises, le domaine que j’avais choisi.
Les gens sont différents.
Je n’ai jamais ressenti de ressentiment envers les personnes pauvres.
Parmi mes amis qui se trouvaient dans une situation similaire, certains en voulaient à la société, et quelques-uns sont devenus militants.
Et qu’ont-ils devenu aujourd’hui ?
Ces mêmes personnes mènent aujourd’hui une vie confortable dans la société capitaliste et bénéficient d’un traitement favorable.
Où est passé leur ressentiment ?
J’étais pauvre à l’époque, et je le suis encore aujourd’hui.
Pourtant, je vis une vieillesse spirituellement riche.
Ma pauvreté de jeunesse n’a pas dicté le cours de ma vie.
J’avais simplement un désir passionné d’étudier les classiques chinois.
Pour cela, j’ai cumulé plusieurs emplois de tuteur afin de pouvoir m’acheter les livres nécessaires.
Je n’ai jamais blâmé la pauvreté de ma famille.
À l’époque, et encore plus aujourd’hui, l’enseignement universitaire est uniquement considéré sous l’angle économique.
Mais la seule vraie raison d’aller à l’université devrait être la volonté d’apprendre dans un but précis, et non l’argent.
Si vous en avez la volonté, vous pouvez trouver un moyen, financier ou autre.
Comme le disaient les sages de l’Antiquité :
« Le ciel bouge avec vigueur ; la personne noble ne cesse jamais de s’améliorer. »
« Quand on veut, on peut. »